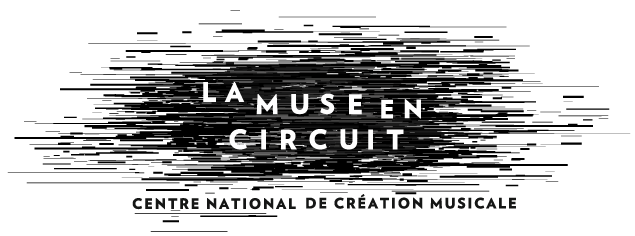Typique de cette génération de créateurs pour lesquels il est bien plus naturel d’opérer une synthèse pragmatique de leur héritage culturel multiple que de revendiquer une filiation, Alexander Schubert a fortement impressionné Musica l’an dernier avec son Codec Error. Il mêle volontiers pop, électronique, techno ou free jazz – autant de musiques qu’il a pratiquées sur scène – à une approche écrite de la composition. Une démarche qui va comme un gant au Decoder Ensemble, dont Schubert figure justement parmi les fondateurs.

Son portrait musical révèle certaines des constantes de sa production artistique. L’importance accordée au corps des interprètes, la forte utilisation de l’électronique pour la production sonore, la présence croissante de la scénographie lumineuse, ou encore la puissante charge énergétique font de chacune des pièces une performance. Le Decoder Ensemble s’est constitué dès l’origine sur une telle base.
Les quatre musiciens alignés sur scène dans Sensate focus (2014) ne sont d’abord visibles que par intermittence et jamais tous ensemble. Cithare électrique, clarinette basse, violoncelle et percussion appellent chacun une gestuelle spécifique et passent brusquement de l’ombre à la lumière dans le ballet stroboscopique de faisceaux lumineux très directionnels. Dans Point Ones (2012), c’est véritablement le chef « augmenté » par des capteurs de mouvement qui déclenche les séquences électroniques. Le discours repose principalement sur de brèves actions répétées, qui lui confèrent un débit spasmodique, voire convulsif. Schubert joue astucieusement sur une anthologie de gestes et de codes emblématiques de la direction d’orchestre, ainsi que sur leur ambiguïté : dirige-t-il un ordinateur ou les musiciens qui lui font face sur scène ?
Conçu pour un ensemble variable devant comporter au moins cinq interprètes et deux performers, f1 (2016) reprend le principe stroboscopique, mais développe grâce à la vidéo une dimension dramaturgique plus sophistiquée. La pièce Acceptance (2018) va encore plus loin puisqu’elle repose en grande partie sur un pseudo-documentaire à teneur ethnologique, tourné pendant les quatre jours d’immersion de la clarinettiste Carola Schaal en pleine nature, où elle a dû construire, par ses propres moyens, une grande croix inversée, qui semble prendre une valeur à la fois totémique et symbolique. Sur scène, la clarinettiste raconte, commente et contrepointe le film en musique et en paroles, dans une réflexion introspective où l’implication émotionnelle prend progressivement le pas sur l’objectivité.